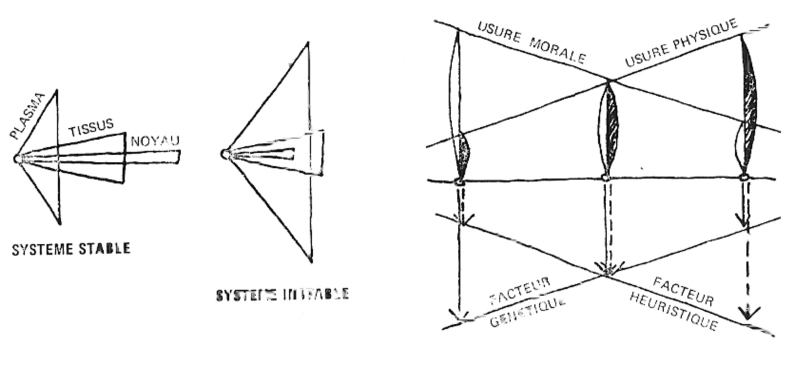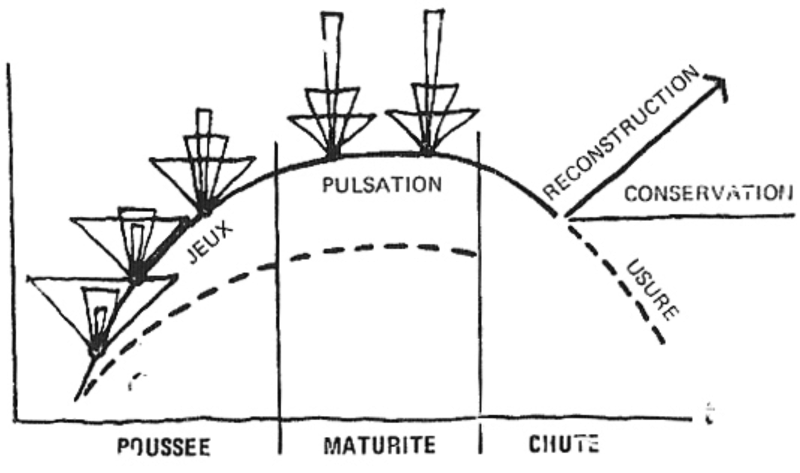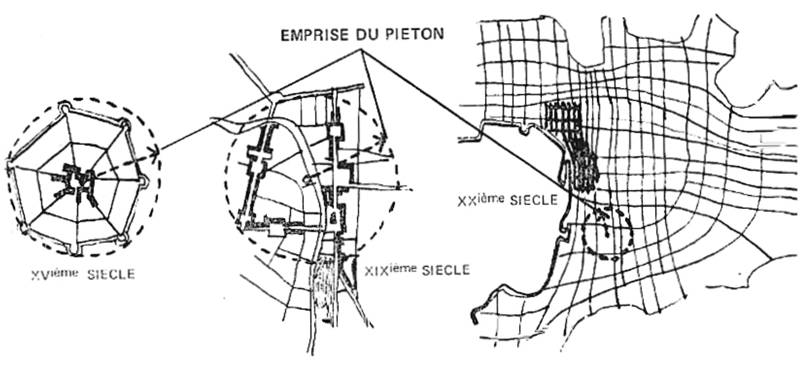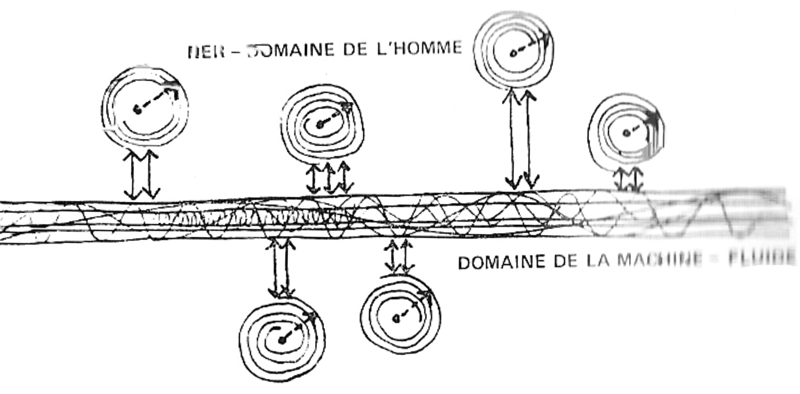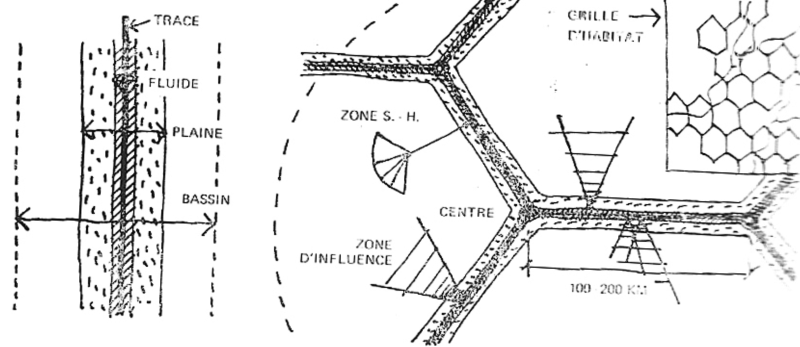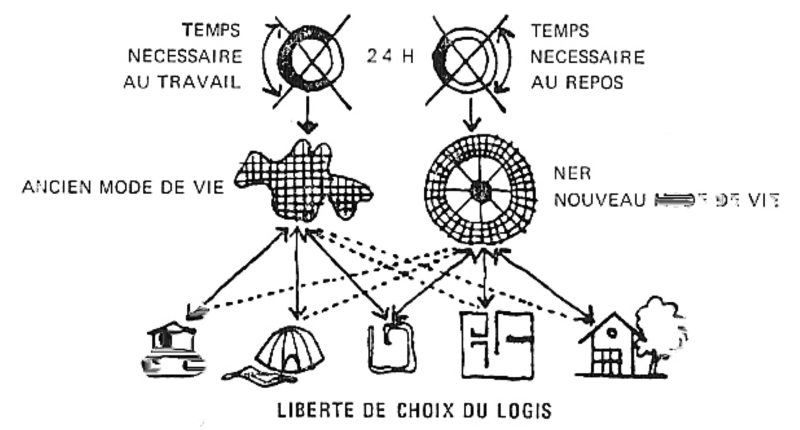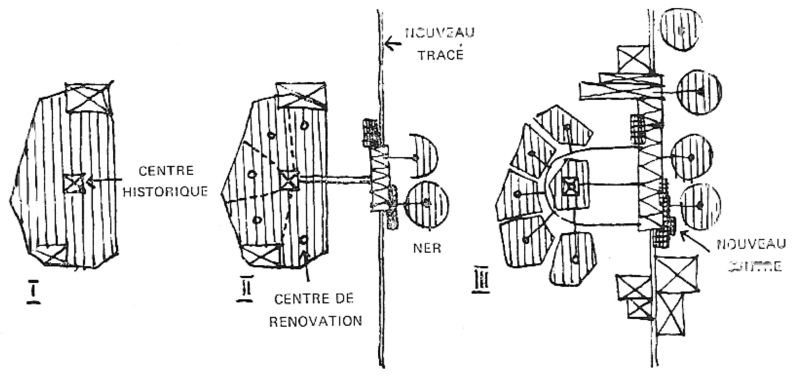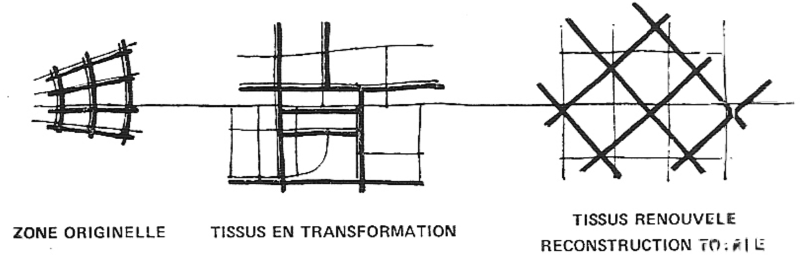Nikolaï Milioutine et le NER
«La ville soviétique doit être honnête et simple dans ses formes, comme est honnête et simple la classe ouvrière; diversifiée, comme l’est la vie; seuls les éléments dont sont composés les édifices doivent être standardisés et non les édifices eux-mêmes; économique dans le matériau utilisé et l’entretien et non dans l’espace et le volume; joyeuse, comme l’est la nature. Enfin, elle doit être commode, claire, hygiénique.»
Milioutine
Figure emblématique de l’urbanisme socialiste, Nikolaï Milioutine (1889-1942) sera très influent (particulièrement pendant les période d’édification des deux premières générations de villes nouvelles en Union soviétique: 1930-1939 et 1939-1959) à travers son livre Sotsgorod qu’il publie en 1930 en tant que président de la Commission pour la construction des villes soviétiques. Inspiré des doctrines marxiste, fordiste et léniniste, du mouvement moderne fonctionnaliste étranger et de l’art constructiviste soviétique (Alexandre Vesnine, précurseur de l’idée selon laquelle les formes sont conditionnées par leur utilité), il préconisera une architecture sans ornement, où la lumière et la ventilation naturelles doivent être protagonistes.
Il développe ainsi la notion de micro-raïon en dérive, avec l'idée essentielle de faire primer la communauté sur l’individu.
Le micro-raïon est «composé d’un complexe d’immeubles de logements et de bâtiments pour les services de la vie quotidienne pour la population (jardins d’enfants, crèches, écoles, cantines, équipement commercial de proximité, aires de sport et jardins)». Il sera l’unité fonctionnelle élémentaire de la ville soviétique, puis se répandra dans les pays d’Europe de l’Est à partir du milieu des années 1950.
L’assemblage des cellules d’habitation et des équipements proposés par Milioutine suivait le concept de ville linéaire et pouvait être implanté «en ligne le long de la route» ou «en pignon sur le bord de la route». Chaque micro-raïon forme un grand bloc et leur juxtaposition standardisée dessine un tissu en damier. Le paysage urbain qui en résulte est comparable à celui formé en France par l’uniformité des grands ensembles banlieusards. La création de la ville de Navoï en Ouzbékistan, par exemple, a nettement suivi cette structure de micro-raïons et les zones résidentielles se rassemblent autour du centre civique, commercial et administratif.
Ainsi il proposa à plusieurs reprises des modifications pour une organisation linéaire capable de se développer dans les deux sens, suivant le système de la chaîne de production par juxtaposition de bandes parallèles: chemin de fer, usine, zone verte, route, zone résidentielle, parc, rivière. L’organisation idéale pour Milioutine était celle qui minimiserait les temps de déplacement entre l’habitat et le lieu de production.
Dans la planification de la ville socialiste, l’idée de Milioutine s’appuyait sur deux grands principes :
L’ouvrier socialiste devait pouvoir accéder à pied à l’usine. Réduire les infrastructures coûteuses était un des paris de Milioutine. Pour lui, un petit nombre de bus, taxis et bateaux remplaceraient les tramways, viaducs et tunnels. Les infrastructures nécessaires aux “travail - vie” de l’ouvrier socialiste doivent toutes être implantés dans un rayon réduit autour de son habitat.
La création de milieux naturels, indispensables au repos du travailleur socialiste. Ainsi Milioutine développa l’idée de groupements urbains en constellations le long des axes de transports, séparés les uns des autres par des parcs, jardins, lacs...servant alors aussi de ceintures vertes protégeants les centres urbains des zones industrielles.
Présentation d’un modèle de développement urbain soviétique linéaire dérivé des théories de N.Milioutine :
Le NER
1.Orientation - Variabilité et stabilité
1.1 Universalité du modèles dynamique du système spatial
Chaque système spatial (ouvrage, complexe urbanistique) se compose de zones qui varient de manière différentes :
noyau - squelette -”code” génétique (A)
tissu - corps du système - matériau de construction (B)
plasme - couche protectrice - domaine de mutation (C)
Dans une habitation : les constructions principales (A); les cloisons, planchers (B); les murs, loggias, jardins (C).
Dans une ville : système de voirie (A); implantation de l’habitat (B); ouvrages temporaires, verdure (C).
1.2 Stabilité temporaire - spatiale
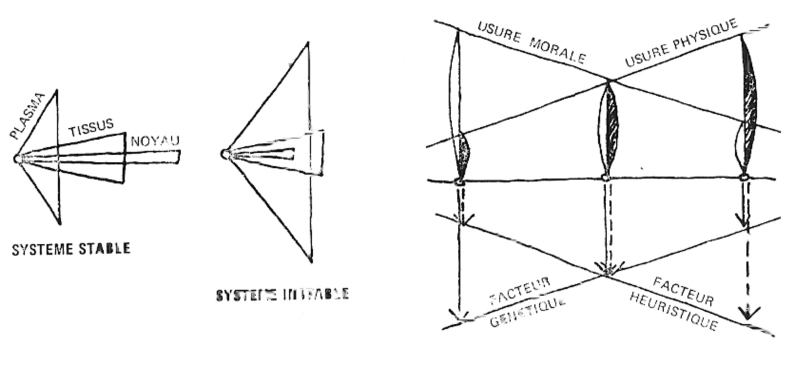
Le rapport des noyaux, tissu et plasme détermine le degré de variabilité du système -sa stabilité temporaire- spatial.
Plus le nombre d’éléments du système pouvant être rapporté au noyau est grand, plus sa stabilité est grande.
La stabilité relative du système -délais d’usure morale- excède les délais physiques (cellule d’habitat, centre civique, quartier d’habitations).
A sa base -les besoins qui varient peu dans le temps (sphère biologique et sociale)- le facteur génétique. La stabilité relative du système -l’usure morale- commence avant l’usure physique (zone industrielle, centre administratif, agglomération). L’influence des besoins variant par suite du progrès technique (sphère économique et sociale) prédomine -facteur heuristique.
1.3 Cycle vital du système
Chaque système spatial ressemble à un être vivant - il naît, croît, atteint la maturité et succombe.
Un système mûr est toujours plus stable que ce même système au stade de sa croissance. La croissance c’est l’accession à la stabilité : le noyau n’est pas encore fort, le plasme joue un grand rôle (échafaudages, ouvrages temporaires) - le système est instable.
A mesure que le système se développe, le noyau invariable rigide se cristallise, le système acquiert la stabilité.
Mort du système :
Conservation : perte totale de souplesse, ossification.
Stabilité absolue : transformation en monument.
Désintégration fonctionnelle : perte complète de stabilité.
Rigidité absolue, destruction de la structure interne suivie de la destruction physique ou de la reconstruction radicale.
1.4 “Comportement” observé du système et stratégie des études
Le comportement observé du système dépend de sa nature (structure fonctionnelle, échelle des dimensions) et du stade d’évolution.
Deux cas sont possibles :
Pulsation : la stabilité de système au passage d’un état à l’autre demeure constante - métabolisme, perfectionnement harmonique. C’est ainsi que se comporte un système stable à la phase suprême du cycle vital.
Jeu : évolution avec modification de la stabilité - processus incontrôlable, adaptation souple. C’est le comportement d’un système instable, d’un système en général au stade de croissance ou de désintégration.
Un centre civique, une colonie ou un quartier d’habitation (commune urbaine) pulsent; un complexe de logements en évolution, une agglomération jouent.
Etude d’un système pulsant : maximum de détermination, minimum nécessaire de souplesse sont assignés : l’assortiment d’indices fixés à demeure (le noyau) déterminant l’ensemble, le caractère architectural généralisé.
Etude d’un système qui joue : souplesse maximale, minimum nécessaire de détermination. L’étude détermine l’élément stéréotype (le tissu) et comment il s’intègre sans le système.
1.5 Variété du milieu vital
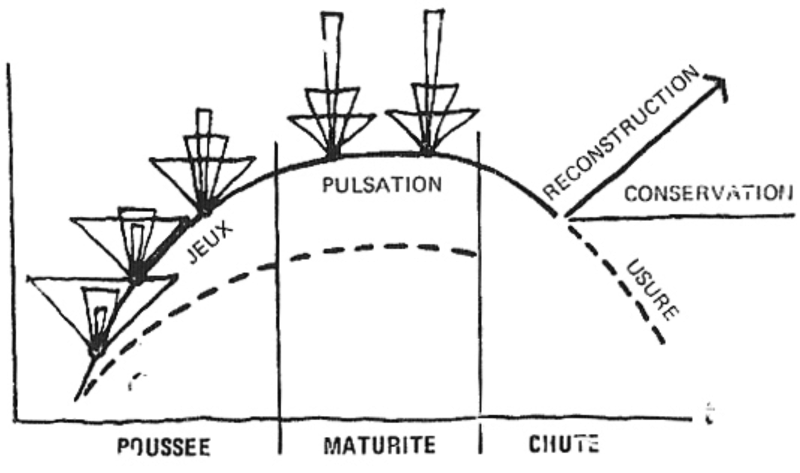
Systèmes stables et instables, deux pôles entre lesquels toute la variété du milieu vital est incluse :
-caractères unitaires et de masse,
-caractère architectural et architecture d’information,
-action active sur l’homme et liberté de choix.
Aujourd’hui l’architecte n’a pas le droit d’ignorer cette contradiction dialectique. Le monde figé et limité du fonctionnalisme traditionnel est aussi incomplet que le monde du dynamisme fugitif, alternatif, incapable de créer des valeurs. Le respect de la tradition dans l’esprit de la nouveauté ne doit pas nous cacher la vérité, il n’y a qu’un milieu vital de l’homme. Les systèmes stables et instables doivent s’y combiner conformément à la nature et l’utilité humaine du type d’activité vitale qu’ils organisent.
2.Objectif - le monde de l’homme et le monde de la machine
2.1 Histoire : milieu à l’échelle de l’homme
L’histoire de l’urbanisme relève différents étapes de la conformité de l’homme et du milieu vital.
De l’unité aux complexes et, en fin de compte, jusqu’à l’agglomération, l’échelle humaine des proportions des ouvrages se prolonge dans les limites du rayon naturel piétonnier et domine dans l’espace de la ville.
Le temps détruit l’harmonie de la ville du Moyen Age. Les places et artères du Classicisme s'efforcent encore de concilier la ville aux échelle de la perception humaine. Mais les vagues de urbanisme envahissent toujours davantage les vieilles villes et les paysages environnants.
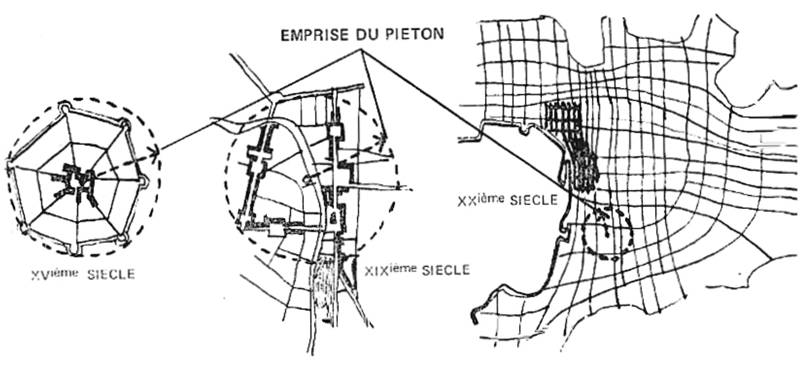
2.2 Aujourd’hui : le vide
La ville contemporaine sert à la voiture. Il y reste toujours moins d’espace et de distance à la mesure de l’homme.
La voiture, ce n’est pas seulement un équipement technique et un moyen de transport. La voiture, c’est la formule de vie d’une grande ville contemporaine. C’est l’irruption massive de la technique, une croissance quantitative qui n’es pas liée à la structure interne reconçue.
La voiture transforme la ville en un genre de coin perdu. La ville, née d’une nécessité de l’homme et des relations, devient aujourd’hui un désert.
2.3 Demain : différentiation consciente
Il faut avoir pleine conscience que :
-l’homme ne peut pas vivre aujourd’hui sans voiture,
-la voiture ne peut pas exister sans l’homme,
-l’échelle des mesures et du rythme d’activité, la nature et la construction de l’homme et de la voiture sont absolument différentes.
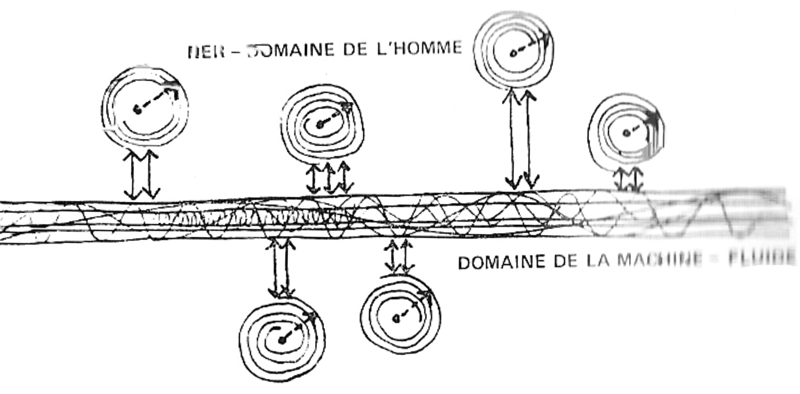
Pour que l’homme et la voiture puissent exister, il faut leur assurer toute liberté d’évolution; il faut différencier le milieu spatial.
La ville doit être moins homogène, ne pas être privée d’orientation par l’espace dans lequel la voiture n’a pas un régime d’existence optimal et l’homme ne peut jouir d’une vie pleine et joyeuse.
La ville doit associer l’espace des voitures et l’espace des habitants.
La monde des voitures -lit de peuplement- est la concentration de l’activité et de l’échange d’informations; structures ouvertes, instables, sans début ni fin, tradition ni caractère.
L’espace cesse d’y être réel, il ne se mesure que par le temps que l’homme dépense à le surmonter. L’homme ici a conscience qu’il fait partie d’une collectivité organisée.
Le monde de l’homme -le NER- colonie, le lieu de vie de l’homme, est le secteur du milieu vital à sa mesure qu’il est en état de percevoir en tant qu’unité. Ici le cours du temps est cristallisé en tradition culturelle et caractère architectural.
Ici l’homme est initié à l’éternité en prenant conscience qu’il fait partie du genre biologique.
Ici, pour l’homme, l’espace renaît en tant que réalité qu’il est en mesure de percevoir. Cette sensation d’espace, dans lequel nous existons, qui nous appartient, simple et nécessaire, comme notre corps ou notre parole, est à la base même de l’expérience humaine. Et plus l’homme avancera dans la voie du progrès, plus son besoin de revenir à ce point initial sera aigu et constant.
3.Méthode - linéaire - centrée - peuplement
3.1 Rivières de peuplement
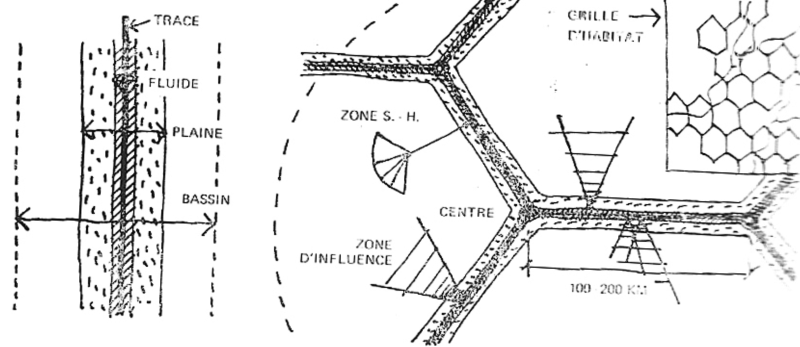
Les fonctions sont séparées dans l’espace (suivant les zones).
Artères, ligne des communications, super-routes - zone de mouvement.
Lit, lieu de travail, de production - zone d’activité.
Vallée, habitat - zone de rénovation.
Bassin, territoire de réserve, nature découverte - zone d’influence.
L’artère forme le champs d’espace artificiel qui dénature et transfigure le site existant. La tension de ce champs diminue vers la périphérie : depuis l’ouvrage technique pur de l’artère vers les espaces découverts du bassin.
3.2 Métasystème
Les zones spatiales sont reliées en un système unique qui couvre les territoires de la région, les pays du continent.
Le développement linéaire des zones spatiales s’associe au développement ponctuel des centres. Un processus réglemente l’autre.
Hiérarchie des centres :
-selon le type, centres de rénovations et d’affaires,
-selon l’échelle, local, spécialisé ou métropolitain.
Dans les régions de pionniers, la trame de peuplement règle la nouvelle construction sur la base de la mise en valeur des territoires naturels. Dans les régions déjà mises en valeur - “relâchement” de la trame existante, reconstruction décisive des territoires mis en valeur, libération des territoires utilisés irrationnellement et rénovation du paysage naturel.
3.3 Deux types de colonies
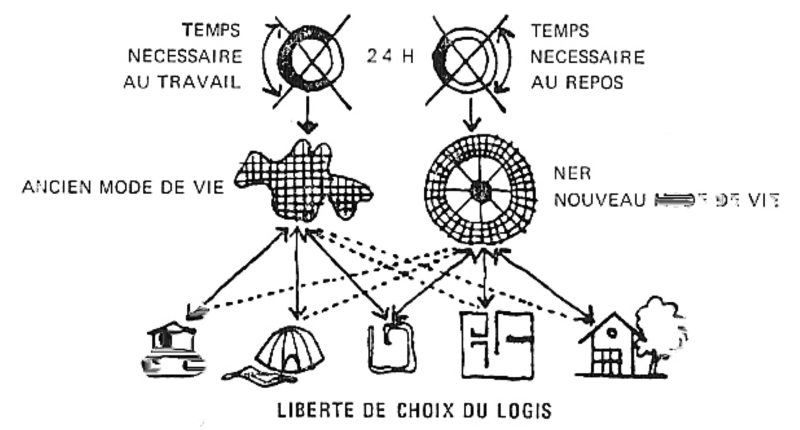
Comment l’homme dépense-t-il son temps ?
Le terme “temps libre” implique la possibilité du choix individuel :
-dans la sphère de rénovation,
-dans la sphère de production,
en fonction de l’âge, tempérament, profession, tendances individuelles, etc...
Deux extrémités, deux modes de vie, deux types de colonies : le NER et le STRAT. Dans chacun d’eux, tout type d’habitat, depuis la capsule minimale jusqu’à la maison confortable. La différence ne réside pas dans l’organisation des cellules de logements mais en ce qu’elles forment une unité urbanistique.
NER -nouvel élément de peuplement. Population d’environ 100 00 habitants; rayon piétonnier.
Vie saturée d’une collectivité sociale développée, évolution harmonique de la personnalité en un organisme architectural unique, noyau et son expression la plus haute, le centre des relations.
Le NER est individuel et stable, il est nettement tracé dans l’espace, il conserve la tradition et engendre le caractère architectural. Les NER peuvent exister dans le système de peuplement linéaire, centré, soit comme colonies différenciées, soit comme quartiers urbains.
Le NER, c’est la cellule qui forme le tissu de la ville moderne. Le STRAT est le complexe d’un peuplement actif temporaire. Le nombre d’habitants et la longueur dans l’espace ne sont limités par rien. Accumulation mécanique de cellules individuelles, villes-dortoirs, villes-hotels. Le STRAT n’a pas de structure, il est instable, déborde dans l’espace et apparaît là où l’activité productrice est concentrée.
Le STRAT, ce sont les cités des bâtisseurs et les habitants temporaires des ouvriers saisonniers, les hôtels dans les centres métropolitains et les foyers des étudiants.
4.Réalisation - reconstruction
4.1 Au niveau de l’agglomération
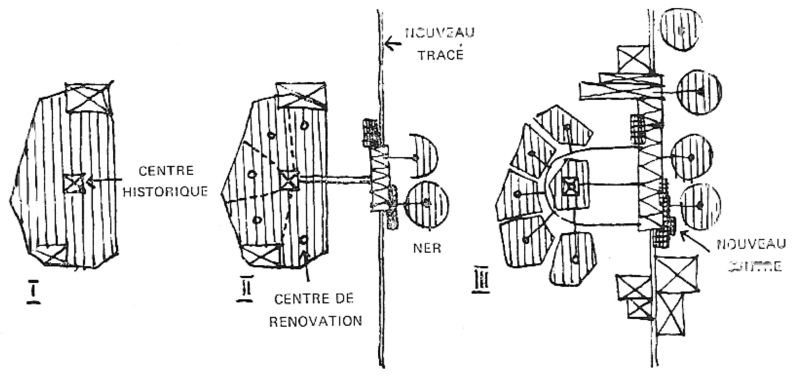
Choix du lit principal, la vieille agglomération obtient un nouveau point de comptage. Le nouveau centre de la capitale est déporté en dehors du centre de formation historique.
La création de centres locaux de rénovation régénère la structure traditionnelle centrique de l’agglomération.
Les habitations amorphes sont désintégrés en quartiers urbains du type NER. Elles entrent au même titre que les nouveaux NER dans la structure du peuplement linéaire, centré.
4.2 Au niveau de la colonie
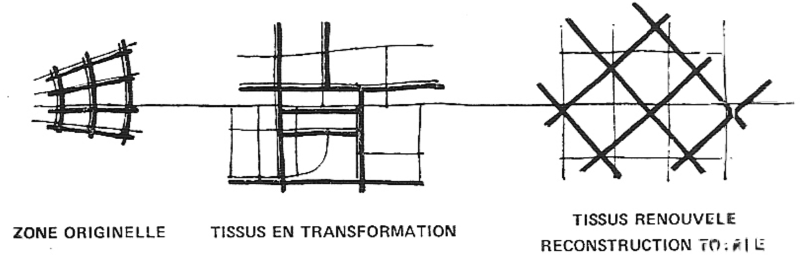
Trois zones de reconstructions dans les limites de la ville déjà formée :
-zone de conservation (centre), subordination complète au milieu urbanistique existant, “imitation”.
-zone de régénération, conservation des éléments de la structure d’aménagement déjà formée, son intégration organique dans la structure nouvelle.
-zone de reconstruction totale, création de nouveaux “centres de comptage”, réorientation graduelle de la structure existante, sa destruction totale, fin de la formation de la structure. La situation urbanistique concrète détermine le rôle des ouvrages dans le processus de reconstruction, élément de soutien passif ou facteur de régénération actif.
Alexei Goutnov, Ilja Léjava